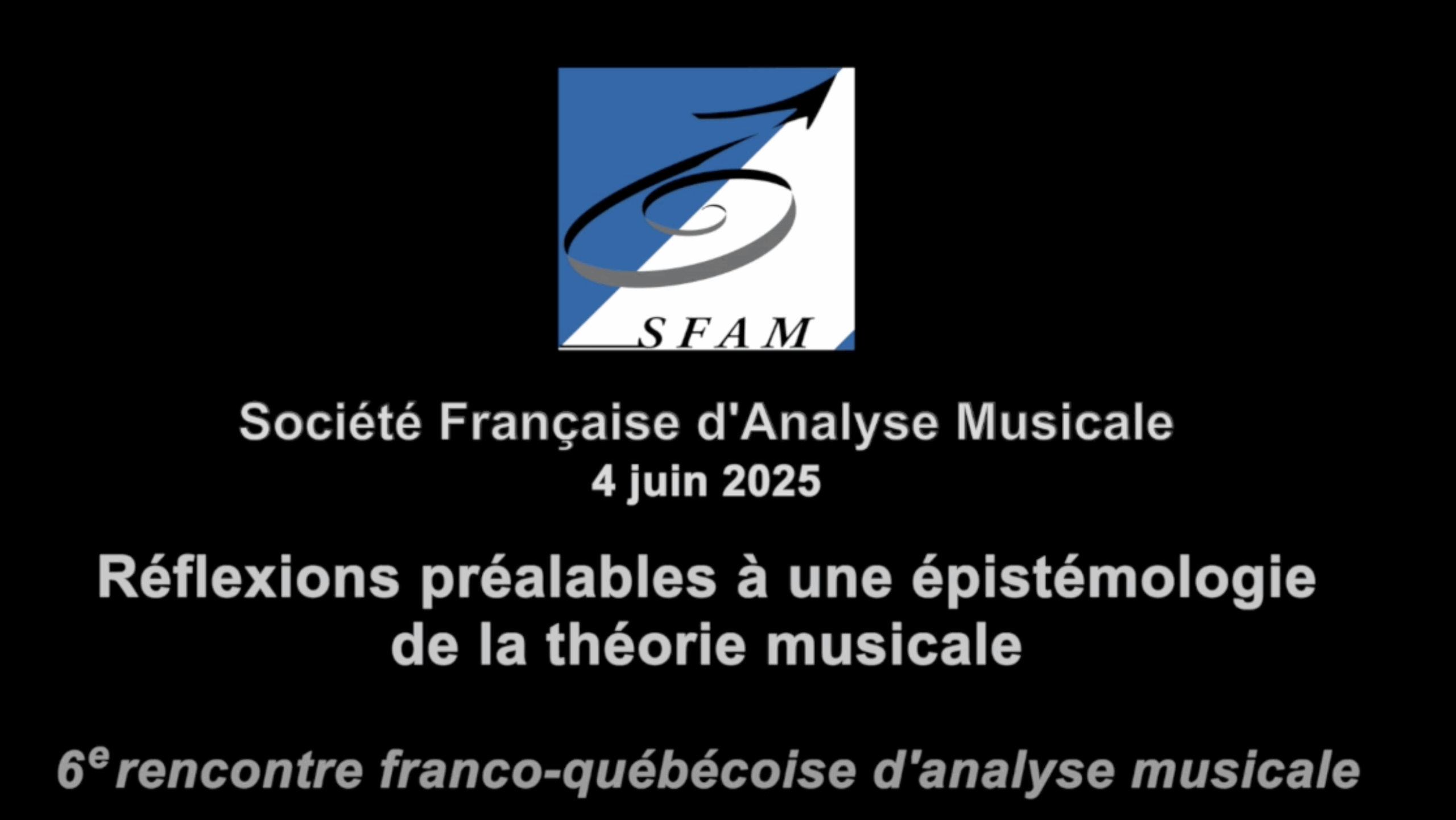Titre : Réflexions préalables à une épistémologie de la théorie musicale
Date : mercredi 4 juin 2025, 17h-19h (France) / 11h-13h (Québec)
Lieu : par visioconférence, sur inscription (lien de connexion transmis par courriel)
Langue : français
Organisation : Jean-Pierre Bartoli, Sylvain Caron, Adam Filaber, Arthur Skoric
Institutions partenaires : Société Française d’Analyse Musicale (SFAM) et Observatoire Interdisciplinaire de Création et de Recherche en Musique (OICRM)
* * *
VIDÉO DE L’ÉVÉNEMENT
* * *
PROGRAMME ET INSCRIPTION
Cette rencontre propose d’interroger la notion même de « théorie musicale » en tant qu’objet de savoir. Au-delà de son inscription historique, il s’agit de réfléchir à la manière dont les théories musicales se construisent, se transmettent et se transforment à travers les époques, selon des cadres culturels, scientifiques et idéologiques spécifiques.
Plutôt que de considérer la théorie comme un simple miroir de la pratique ou comme un système clos de règles, il est possible d’y voir une forme de méta-production du savoir, où les théoriciens participent activement à la définition des objets qu’ils analysent. Cela suppose également une attention particulière portée aux termes employés, à leurs implications conceptuelles et à leur pouvoir de structuration des discours musicaux.
Enfin, la théorie musicale n’est pas une discipline autarcique par rapport au fait musical global. Au contraire, elle interagit avec lui, notamment pour tout ce qui concerne la formation des musiciens, compositeurs comme interprètes, et, à certaines époques en particulier, avec la pratique musicale. La réflexion sur la théorie s’intéresse donc aussi bien au contexte dans lequel elle est élaborée qu’aux prismes des différentes époques qui s’approprient ces théories.
Quelques axes de discussion :
- Qu’est-ce que la théorie musicale ? Quels statuts et fonctions lui attribue-t-on ?
- Comment les époques et contextes culturels influencent-ils la manière de théoriser la musique ?
- Le concept de théorie musicale a-t-il des propriétés stables ou change-t-il avec chaque époque, paradigme ou épistémè ?
- Quel est le rôle des disciplines extra-musicales dans la théorisation de la musique ?
- Comment la théorie s’adapte-t-elle à l’évolution permanente de la pratique musicale ?
- En quoi les théoriciens (et chercheurs) participent-ils à la construction de leurs propres objets ?
La séance sera modérée par Marc Rigaudière (Université de Reims-Champagne Ardennes, SFAM).
- Théodora Psychoyou (Sorbonne Université, IReMus), Pour une histoire de l’épistémologie de la théorie musicale : l’exemple de la première modernité et de ses changements de paradigme
Partant de ce que recouvrirait une épistémologie de la théorie musicale, nous discuterons des façons d’aborder aujourd’hui le discours sur la musique dans son historicité, en prenant pour exemple les dynamiques de la modernité autour du XVIIe siècle. Il sera question de statut de sources (des auteurs, des lecteurs, des supports, des genres d’écrit, même des périmètres disciplinaires) et de la façon dont les stratégies discursives sont mobilisées, dans des structurations sinon progressives au moins connexes (théoriser = penser, écrire, forger des systèmes de représentation, procéder par empirisme ou comparatisme, se positionner vis-à-vis des autorités notamment). La période concernée est exemplaire par la façon dont les fondements de la discipline, les critères de scientificité et les méthodes de production de la théorie sont abordés ; les étudier engage une prise en compte de perspectives aux évolutions non-synchrones, éclairées conjointement par l’histoire de la musique, l’histoire des sciences et l’histoire des idées.
- Sandro Guédy (Université de Montréal, Université Libre de Bruxelles), Les premières réceptions analytiques de Béla Bartók en France : acteurs, concepts et enjeux
Parmi les grandes figures du milieu musical occidental du XXe siècle, Béla Bartók s’impose comme un pôle majeur d’intérêt analytique. Si certaines caractéristiques de son langage peuvent être abordées par les outils d’analyse traditionnellement appliqués au répertoire du XIXe siècle, la singularité de son écriture incite également à remettre en question ces mêmes outils et à renouveler les perspectives théoriques et méthodologiques. Pour cette présentation, je propose d’étudier les premières réceptions analytiques de l’œuvre de Bartók en France en mettant en lumière plusieurs acteurs clés, notamment Serge Moreux, André Jolivet, Darius Milhaud, Paul Le Flem et Olivier Messiaen, ainsi que les concepts mobilisés – parfois forgés – afin d’appréhender une musique dont l’hybridation stylistique repousse les limites des méthodes d’analyse conventionnelles. Dans quelles mesures ces premières réceptions ont-elles contribué à renouveler les cadres analytiques existants ?
- Christophe Guillotel-Nothmann (CNRS, IReMus), Entre forme et culture : quelques réflexions sur une historiographie de la théorie musicale axée sur l’évolution des concepts théoriques et sur leur actualisation à travers notre perspective actuelle
La New Musicology a pour ambition d’ouvrir la discipline musicologique aux approches critiques des sciences humaines et sociales. L’enjeu consiste à considérer la musique non plus comme une forme autonome, mais comme une pratique ancrée dans des contextes sociaux, politiques et idéologiques. Selon cette perspective, l’étude de la théorie musicale prend, elle aussi, son point de départ dans l’exploration de contextes – scientifiques, philosophiques, idéologiques, esthétiques, confessionnels, etc. –, censés mettre en lumière la manière dont sont forgés les savoirs musicaux. Sans rejeter les apports critiques du renouveau disciplinaire entrepris au cours des décennies passées, mon intervention soutient que la dichotomie artificielle entre forme et culture, la marginalisation des approches structurales et l’exploration de la théorie musicale à partir d’une conception ontologique exclusivement relationnelle s’exposent au risque de vider de l’intérieur l’objet d’étude musicologique. Partant de ce postulat et en questionnant la réflexion historiographique qui sous-tend les projets existants – notamment la Geschichte der Musiktheorie (Ertelt, Keym, Zaminer et al., 1984-) et la Cambridge History of Western Music Theory (Christensen 2002) –, je soumettrai un certain nombre de thèses à la réflexion générale dans l’optique d’envisager une histoire théorique intrinsèquement musicale : une histoire centrée sur la musique en tant que système, ancré dans un environnement socio-culturel et susceptible d’interagir avec lui.
- Marc Rigaudière (Université de Reims Champagne-Ardenne, CERHiC, SFAM), Étudier les théories de la musique et leur histoire : quelques questions préliminaires
L’étude des théories de la musique et de leur histoire fait sans cesse ressurgir des interrogations fondamentales auxquelles il est difficile de se dérober. Dans cette brève intervention, j’évoquerai deux familles d’interrogations : celles qui concernent l’essence de la théorie musicale (qu’est-ce qu’une théorie de la musique ? les écrits habituellement considérés comme théoriques, et en particulier les traités, comportent-ils toujours une dimension théorique ?), et celles qui concernent son traitement historiographique (comment peut-on rendre compte de la vie des concepts théoriques dans la durée ?, comment peut-on construire un examen critique des théories musicales ?).
Inscription sur demande avant le 02/06/2025 à l’adresse contact@sfam.org, en indiquant vos nom, prénom et affiliation (membre SFAM à jour de sa cotisation ou membre OICRM). Le lien d’accès à la séance en ligne sera transmis par courriel la veille de l’événement.
La rencontre sera enregistrée et publiée sur la chaîne YouTube de la SFAM.